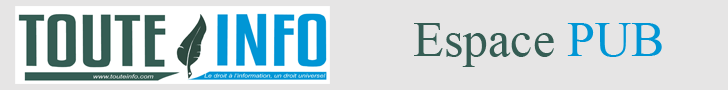BURKINA FASO : « IL Y AURA D’AUTRES SOUBRESAUTS SOCIOPOLITIQUES »
dimanche 1er novembre 2015
Après l’insurrection populaire et la victoire sur le putsch, place aux élections présidentielle et législatives le 29 novembre, censées mettre fin à la transition. Mais, de l’avis du Pr Mahamadé Savadogo, la longue tradition de luttes des Burkinabè et leurs aspirations profondes se manifesteront encore les mois à venir.
Propos recueillis par Amidou Kabré
(Afrique Asie, novembre 2015)

Mahamadé Savadogo est professeur de philosophie à l’université de Ouagadougou, mais aussi coordonnateur du mouvement du Manifeste des intellectuels pour la liberté. Cet intellectuel engagé nous a reçus dans son bureau de l’université.
En moins d’un an, les Burkinabè se sont posés en champion de la défense de la démocratie, avec une insurrection populaire et une révolte victorieuse contre un coup d’État. Cela a surpris bien d’observateurs, et même suscité l’admiration en Afrique et sur la scène internationale. Et vous ?
Pour ceux qui, comme moi, ont suivi l’évolution de la vie politique au Burkina Faso, en particulier depuis la mobilisation contre l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses trois compagnons en 1998, l’évolution récente n’a rien de surprenant. Depuis ce triste épisode, on a assisté à d’autres événements catalyseurs. En 2008, il y a eu ce qu’on a appelé « les émeutes de la faim » contre le renchérissement du coût de la vie ; en 2011, les mutineries de l’armée ; à partir de 2013-2014, la mobilisation contre la création du Sénat puis contre le projet de révision de l’article 37 de la Constitution. Cette succession d’événements a contribué au développement des capacités de mobilisation populaires, avec l’appui des différentes organisations politiques et de la société civile. La colère contre le régime de Blaise Compaoré n’a cessé de grandir. Jusqu’à l’explosion de l’insurrection.
Les révoltes du passé sont-elles toujours dans l’imaginaire collectif ?
Sans doute le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, sous l’impulsion des syndicats qui contestaient la gestion du pays de Maurice Yaméogo, reste-t-il dans la mémoire populaire, en dépit de la récupération de l’armée qui a pris aussitôt le contrôle de la situation. Depuis la période coloniale, plusieurs acteurs sociaux se sont fait entendre. Nous avons une tradition de contestation, avec des organisations politiques de gauche et d’extrême gauche qui ont essaimé dans la population, lui ont parfois appris à défendre ses droits, à se battre pour le changement. Nous pouvons compter avec de nombreuses organisations de la société civile ou des mouvements de défense des droits de l’homme. Lors de l’affaire de Norbert Zongo, nous avons vu la formation du Collectif des organisations de masse et des partis politiques, la Coalition contre la vie chère, sans oublier les nouvelles organisations de la société civile qui sont nées à la faveur de la lutte contre la révision de l’article 37. Il y a donc eu toute dynamique, une évolution historique sur plusieurs années qui a suscité des acteurs nouveaux et qui a engendré des formes de mobilisation propres à notre pays.
L’opposition parlementaire au régime de Compaoré était fort composite. Quel a été son véritable rôle dans le déclenchement de la révolte d’octobre 2014 et dans la résistance contre le coup d’État ?
Les partis politiques institutionnalisés tels que l’Union pour le progrès et le changement (UPC), le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et l’Union pour la renaissance/Parti sankariste (Unir/PS) ont été en première ligne. Bien sûr, ils n’étaient pas seuls. Le chef de file de l’opposition, Zéphirin Diabré, a lui-même reconnu que les gens qui descendaient dans la rue ne cessaient de croître en nombre et en détermination.
La mobilisation a été portée en grande partie par les jeunes. Que vous inspire cette jeunesse du Burkina qui fait parler d’elle au-delà de nos frontières ?
D’un point de vue purement statistique, il faut relever son poids : plus de 60 % de notre population a aujourd’hui moins de 30 ans. Une grande partie de la population est née sous le règne de Blaise Compaoré, et ces jeunes aspirent au changement. Leur participation aux mouvements politiques n’est pas un phénomène nouveau chez nous. Les organisations d’étudiants et d’élèves ont une longue tradition. J’ai moi-même commencé à découvrir le militantisme avec des associations d’élèves pendant les vacances à Ouahigouya, ma ville natale, puis à l’Association des étudiants et scolaires de Ouagadougou. Le poids démographique de la jeunesse et cette tradition de contestation sont à l’origine de l’expression d’une forte aspiration au changement, à une plus grande justice sociale.
Peut-on qualifier les luttes politiques et sociales auxquelles on a assisté depuis un an de révolutionnaires ?
Je ne crois pas. Le Manifeste des intellectuels pour la liberté, que je dirige, a tenu un panel le 31 janvier dernier dont le thème était « Insurrection et révolution ». Nous avons clairement démontré que l’insurrection a certes apporté des changements importants, mais qu’on ne pouvait pas encore qualifier ces changements de révolution. Cela dit, nous avons insisté pour rappeler que toute révolution mûrit au long de différentes étapes. Elle ne tombe pas du ciel en une seule fois. Les événements que nous avons vécus, tant l’insurrection populaire que la résistance contre le coup d’État, se sont traduits par un approfondissement du désir de changement et de la conscience révolutionnaire. On peut dire que nous avons réalisé des avancées importantes dans le sens d’une transformation profonde de la société burkinabè.
« TOUTE RÉVOLUTION MÛRIT AU LONG DE DIFFÉRENTES ÉTAPES. ELLE NE TOMBE PAS DU CIEL EN UNE SEULE FOIS. »
Les jeunes Burkinabè ont-ils suffisamment intégré la notion de « philosophie de l’action collective », titre d’un de vos ouvrages paru début 2014, avant la chute de Blaise Compaoré, et leur rôle prépondérant dans ce processus ?
Attention ! Il ne s’agit pas de dire que les jeunes ont un rôle de leaders. Vu leur nombre, leur énergie et leur détermination, ils sont acteurs de premier plan, la force d’exécution. Mais ils n’ont pas toujours une conscience politique suffisante pour savoir quelles sont les formes d’organisation et les étapes par lesquelles il faut passer pour conduire une transformation profonde de la société. Je vous ai rappelé les formes d’organisation que nous connaissons depuis l’époque coloniale jusqu’à aujourd’hui et qui se renouvellent continûment. Quand on passe par exemple du Collectif des organisations démocratiques de masses et de partis politiques à la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la fraude, l’impunité et pour les libertés, avec la formation de groupes de résistance dans les arrondissements et les provinces, on peut apprécier l’évolution des formes d’organisation qui suscitent des tâches nouvelles. C’est à travers cela aussi que la jeunesse se forme.
Contrairement à d’autres cas d’insurrections populaires, il n’y a pas eu de pillages lors de la résistance contre le coup d’État. Est-ce la preuve d’un degré élevé de conscience politique ?
Il faut se rappeler que, durant la résistance, les regroupements de masse ont été systématiquement réprimés, notamment à Ouagadougou. La résistance dans les rues de la capitale a surtout consisté à dresser des barrières à l’intérieur des quartiers et à harceler les forces du Régiment de sécurité présidentielle (RSP) pour les empêcher de réprimer les manifestants. Dans les autres provinces, les citoyens ont eu en revanche la possibilité de se regrouper en plus grand nombre. Les mots d’ordre contre les pillages ont été respectés. L’insurrection populaire était l’expression d’une colère dirigée contre l’entêtement de l’ancien régime à vouloir coûte que coûte réviser la Constitution. Il y a cependant eu des attaques contre les biens de certains notables du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP, le parti de Blaise Compaoré) soupçonnés de vouloir mobiliser des milices contre les manifestants, ou qui étaient des proches de l’ancien président impliqués dans la tentative de coup d’État. La résidence du général Diendéré, à Yako, a ainsi été saccagée.

[ Ph. AFP : À Ouagadougou, des Burkinabé brandissent les portraits des victimes du coup d’État ]
Pendant les manifestations populaires, les images et les mots d’ordre de Thomas Sankara étaient omniprésents. Pourquoi l’ancien président fait-il toujours rêver 28 ans après son assassinat ?
Il a été assassiné, il est donc un martyr. Il a été tué jeune, il avait du charisme. Et même s’il n’avait pas pu réunir toutes les conditions pour mener une véritable révolution, il lui a donné une présence particulière dans la mémoire collective et auprès des jeunes en particulier. Beaucoup ne l’ont pas connu mais le connaissent à travers ses discours, qui ont permis une certaine idéalisation de cette figure désormais incontournable de l’histoire du pays.
Les prises de position de l’Église catholique pendant la crise, donc dans la sphère politique, sont-elles justifiées ?
Oui, car ses prises de position sont collectives. L’Église intervient toujours en tant que regroupement, souvent à l’issue de conférences réunissant les évêques. Ce ne sont pas des prises de position fortuites ou gratuites. Elles sont toujours motivées. L’Église tient à montrer qu’elle est une force organisée et qu’elle ne doit pas demeurer indifférente à la vie politique du pays. Elle intervient après mûre réflexion, et cela lui donne une certaine légitimité.
N’y a-t-il pas de risques que d’autres religions en fassent autant ?
C’est déjà le cas. Dans le débat sur la création du Sénat, les musulmans, à travers certains de ses représentants, ont voulu prendre position. À partir du moment où ils ont un poids dans la société, il leur est difficile de rester indifférents aux crises qu’elle traverse. Il ne s’agit pas de soutenir tel leader ou telle organisation politique, ce qui serait une vraie ingérence, mais de donner des indications générales pour essayer d’orienter leurs membres dans des choix de société.
Comment interpréter l’intransigeance de la France à l’égard du général Gilbert Diendéré, auteur du coup d’État, sachant que c’est elle qui a exfiltré Blaise Compaoré vers Abidjan ?
(Rires) Cette exfiltration a été beaucoup critiquée, au Burkina comme en France. Les dirigeants français ont vite compris que le putsch était profondément rejeté par la société burkinabè et l’ensemble de la communauté internationale, dont l’Union africaine, qui a condamné avec une particulière véhémence le coup d’État. Il y allait donc de la crédibilité de la France.
C’est aussi la France qui a fait sortir le président Michel Kafando de sa résidence surveillée pour l’amener en sécurité chez son ambassadeur…
Oui, mais ces actions, même lorsqu’elles sont bienvenues dans un contexte particulier, traduisent l’emprise encore très forte de la France sur notre vie politique nationale, ce qui est généralement mal vécu par les Burkinabè.
Que dire de la manière dont la communauté internationale a exercé des pressions sur le pouvoir de la transition ?
Les institutions de la transition se sont laissé, dès le début, lier les mains par les pressions extérieures, que ce soit sur la longueur du mandat ou sur ses tâches principales durant cette période. À partir de ce moment, les pouvoirs de la transition ont prêté le flanc aux pressions. Le peuple burkinabè, lui n’attendait pas seulement que la communauté internationale organise des élections ; il attendait aussi qu’elle réponde à certaines revendications sociales, et mêmes politiques. Par exemple la lutte contre l’impunité, ou la dissolution du RSP, revendications constantes des Burkinabè. Leurs attentes à l’égard de la transition allaient bien plus loin que l’organisation des élections.
Les candidats à la présidentielle, fixée au 29 novembre prochain, sont désormais connus. Quelle est votre appréciation de l’offre politique actuelle ?
Clairement, je n’attends pas de changements radicaux de la part des acteurs des élections à venir. Pourtant, l’insurrection populaire et la résistance contre le putsch traduisent des exigences importantes de la société burkinabè. Si on veut lire l’avenir, il faut plutôt regarder vers les facteurs qui ont émergé à la faveur des nouvelles formes d’organisation de ces dernières années, surtout depuis 2014.
Des candidats ont pris une partie active dans la lutte. Ne constituent-ils pas un espoir ?
Il a des nuances, des différences de sensibilité entre ces acteurs, c’est vrai. Mais si on pose la question fondamentale du changement, qui est prêt à rompre avec l’ordre libéral et l’ordre néocolonial ? Vous verrez qu’il n’y a pas beaucoup d’hommes politiques à le vouloir. L’important est que le peuple continue à exiger des changements et reste mobilisé : contre toute forme de domination extérieure et l’injustice dans le pays ; contre le fait que les richesses se trouvent concentrées entre les mains d’une infime minorité, alors que la grande majorité n’a pas accès aux services de base tels que l’électricité, la santé, l’éducation, et l’enseignement supérieur. Sur ces grandes questions, la mobilisation populaire va nous aider à avancer.
Y aura-t-il d’autres soubresauts sociopolitiques après les élections ?
Certainement ! On n’a pas fini de solder les comptes des événements que nous venons de vivre. On s’achemine vers le jugement des responsables de crimes politiques et de sang, mais également de délits économiques. Or, ceux qui sont visés par ces procédures cherchent à y échapper par tous les moyens. Il faudra de la vigilance. Quelles que soient leurs tendances, les dirigeants qui seront élus vont désormais travailler sous haute surveillance populaire. S’il y a des écarts, il faut s’attendre à des formes de protestation, à la poursuite des mouvements populaires. Il faut garder espoir, car le peuple développe sa conscience politique, affine son aspiration au changement auquel il donne un sens de plus en plus précis, et trouve les formes d’organisations pour faire évoluer la société burkinabè.